

Pour faciliter l’apprentissage des langues les professeurs ont souvent proposé à leurs élèves des outils pédagogiques qu’ils avaient eux-mêmes préparés. Beaucoup ont écrit des manuels, d’autres des dictionnaires, moins nombreux sont ceux qui ont eu le courage et la capacité de rédiger les deux.
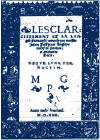 Ces auteurs se retrouvent dès le début de la lexicographie bilingue
au XVIe siècle (Lesclarcissement de la langue francoyse […] de
John Palsgrave de 1530 n’est-il pas le premier dictionnaire bilingue et la première
grammaire contrastive des deux langues, anglaise et française ?). Au XVIIe
siècle, pour le couple franco-italien, nous avons un autre maître : Giovanni Veneroni,
qui publie un Dictonaire italien et françois […] (1681) et une grammaire
Il maestro italiano[…] (1690); en même temps en Angleterre Guy Miège fait
paraître A New Dictionary, French and English, with another, English and French,
[…] (1677) et The Grounds of the French Tongue[…] (1687). Au XVIIIe
siècle aussi, se poursuit cette pratique : Louis Chambaud donne un Dictionnaire
françois-anglois et anglois-françois […] (1776) et des Exercises to the
Rules
and Construction of French Speech […] (1776) tandis qu’aux Pays-Bas Antoine
Nicolas Agron fait sortir un Dictionnaire portatif de phrases et de proverbes
français [...] (1797) à côté de livres d’exercices. Leurs ouvrages étaient
destinés non seulement à leurs élèves mais aussi à tout le public demandeur de renseignements
linguistiques. Nous les considèrerons donc comme dictionnaires généraux et non pas
pédagogiques.
Ces auteurs se retrouvent dès le début de la lexicographie bilingue
au XVIe siècle (Lesclarcissement de la langue francoyse […] de
John Palsgrave de 1530 n’est-il pas le premier dictionnaire bilingue et la première
grammaire contrastive des deux langues, anglaise et française ?). Au XVIIe
siècle, pour le couple franco-italien, nous avons un autre maître : Giovanni Veneroni,
qui publie un Dictonaire italien et françois […] (1681) et une grammaire
Il maestro italiano[…] (1690); en même temps en Angleterre Guy Miège fait
paraître A New Dictionary, French and English, with another, English and French,
[…] (1677) et The Grounds of the French Tongue[…] (1687). Au XVIIIe
siècle aussi, se poursuit cette pratique : Louis Chambaud donne un Dictionnaire
françois-anglois et anglois-françois […] (1776) et des Exercises to the
Rules
and Construction of French Speech […] (1776) tandis qu’aux Pays-Bas Antoine
Nicolas Agron fait sortir un Dictionnaire portatif de phrases et de proverbes
français [...] (1797) à côté de livres d’exercices. Leurs ouvrages étaient
destinés non seulement à leurs élèves mais aussi à tout le public demandeur de renseignements
linguistiques. Nous les considèrerons donc comme dictionnaires généraux et non pas
pédagogiques.
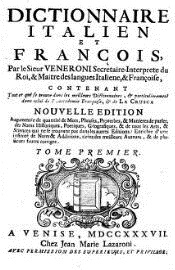 Cependant, au XIXe siècle, se
différencient clairement les dictionnaires généraux des dictionnaires pédagogiques,
en relation avec le développement et la démocratisation progressive de la scolarisation.
C’est alors qu’apparaissent les auteurs-professeurs qui proposent des manuels et
des dictionnaires en Italie (Giovan Battista Melzi, Candido Ghiotti, etc.), comme
en Espagne (Antonio Bergnes de las Casas, Carlos Soler y Arqués, etc.), en Grèce
(Constantin Varvatis, etc.), aux Pays-Bas (Léon P. Delinotte) et ailleurs.
Cependant, au XIXe siècle, se
différencient clairement les dictionnaires généraux des dictionnaires pédagogiques,
en relation avec le développement et la démocratisation progressive de la scolarisation.
C’est alors qu’apparaissent les auteurs-professeurs qui proposent des manuels et
des dictionnaires en Italie (Giovan Battista Melzi, Candido Ghiotti, etc.), comme
en Espagne (Antonio Bergnes de las Casas, Carlos Soler y Arqués, etc.), en Grèce
(Constantin Varvatis, etc.), aux Pays-Bas (Léon P. Delinotte) et ailleurs.
Ils se multiplient au XXe siècle (Carlo Dompé, Gaetano Darchini, Augusto Caricati, Francesco Grimod en Italie, Théophile Antignac, Pedro Fábrega, Rafael Reyes en Espagne, etc.), même si cet usage disparaît progressivement vers la fin du siècle, pour plusieurs raisons concomitantes : la perte de vitesse du français comme discipline scolaire et donc la diminution du public susceptible d’acheter ces dictionnaires, la disparition de l’auteur unique au profit d’un comité de rédaction, le désintérêt de l’usager scolaire pour un dictionnaire spécifique au profit souvent d’un dictionnaire de poche général (moins cher).
L’objectif de ce numéro de Documents est d’analyser ce mouvement transversal dans toute l’Europe aux XIXe et XXe siècles et de faire connaître la production lexicographique des enseignants qui ont publié ces deux types d’outils pédagogiques bilingues avec obligatoirement le français comme l’une des deux langues de travail.
En l’absence d’une biographie connue et publiée de l’auteur, le paratexte (page de titre, préface, etc.) donne souvent des renseignements qui permettent de qualifier l’auteur de « professeur ». D’autre part, les « Vocabulaires », ou index alphabétiques, créés à la fin des manuels qui reprennent, avec leurs traductions, tous les mots présents dans le texte sont à exclure parce que dictionnaires et manuels doivent être autonomes. Enfin, peuvent être considérés comme « manuels » non seulement des « grammaires » mais aussi des « guides de conversation », des anthologies, des cahiers d’exercices, des recueils variés, etc., pourvu qu’ils aient été écrits pour un public scolarisé.
Le paratexte, de même que la nomenclature et les entrées, seront examinés. On évaluera la dimension linguistique (prononciation, néologismes, expressions figurées, etc.), iconographique, encyclopédique, culturelle, pragmatique, idéologique (etc.) de ces ouvrages. On se focalisera sur l’objet dictionnaire tout en tenant compte du rôle qu’a pu jouer la rédaction du manuel.
L’article proposé sera de 35 000 − 40 000 signes maximum, espaces, notes, références, bibliographie, résumés et mots clés compris.
Les propositions de communication devront être adressées avant le 30 octobre 2015 à jacqueline.lillo@unipa.it sous forme de résumé ne dépassant pas 2 000 signes et avec une bibliographie essentielle. L’acceptation des propositions sera communiquée avant le 15 novembre 2015. Les articles devront parvenir avant le 15 janvier 2016, dernier délai. Ils feront l’objet d’une double lecture en aveugle qui déterminera l’acceptation ou le refus de l’article, ou encore la demande de corrections.
La publication est prévue pour juin 2016.