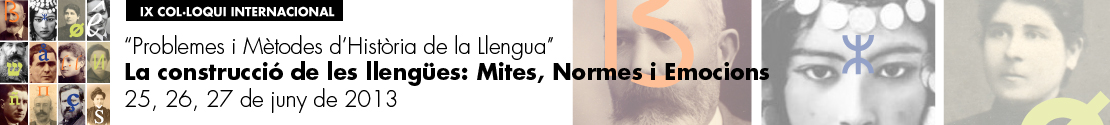
|
IXe
colloque international
La
construction des langues : |
25, 26 et 27 juin 2013
Université de Gérone (Universitat de Girona)
Appel à communication
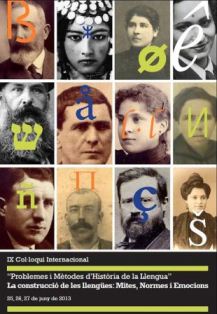 En tant
qu'historiens de la langue, nous croyons que l'objet de notre étude, ce ne sont
ni les langues naturelles ni les idiolectes, que les locuteurs ont
toujours été en mesure de développer individuellement (plus ou moins ce que
Chomsky appelle langue interne, L-I), mais les constructions sociales de référence
partagées par tous les intervenants (plus ou moins ce que Chomsky nomme
langue externe L-E).
Dans ce contexte, l'histoire de la langue a essentiellement pour objet d'étudier la
façon dont une L-E est construite de telle sorte qu'elle peut être
comprise une langue capable pour tous - c'est à dire capable de cacher les
variations de la L-I - et aussi comment le L-E parvient à remplacer la réalité première des idiolectes,
le cas échéant seulement dans
l'imaginaire.
En tant
qu'historiens de la langue, nous croyons que l'objet de notre étude, ce ne sont
ni les langues naturelles ni les idiolectes, que les locuteurs ont
toujours été en mesure de développer individuellement (plus ou moins ce que
Chomsky appelle langue interne, L-I), mais les constructions sociales de référence
partagées par tous les intervenants (plus ou moins ce que Chomsky nomme
langue externe L-E).
Dans ce contexte, l'histoire de la langue a essentiellement pour objet d'étudier la
façon dont une L-E est construite de telle sorte qu'elle peut être
comprise une langue capable pour tous - c'est à dire capable de cacher les
variations de la L-I - et aussi comment le L-E parvient à remplacer la réalité première des idiolectes,
le cas échéant seulement dans
l'imaginaire.
L'écriture représente un tournant décisif de la construction des langues, car elle permet de matérialiser l'abstraction que, jusque-là, les locuteurs ne pouvaient que deviner et tout en entrant en concurrence avec des langues différentes. La langue écrite est une représentation prototypique de la réalité, et devient à son tour partie intégrante de la réalité, pouvant également modifier cette réalité elle-même comme un véritable langage : la plus ancienne ou la seule langue légitime. La presse écrite - et tous les mass-médias à sa suite - favorise le regroupement linguistique au sein des territoires et la stabilité des modèles de référence, posant les bases de l'imposition de telles langues.
À long terme, une telle stabilité contribuera à croire dans l'antiquité des langues, permettra une hiérarchie entre les discours vernaculaires en fonction de la distance à la « langue » et que cette langue devienne l'objectif d'un ensemble de les règles et de normes. En fin de compte, la langue normative sera soumise à un processus de mythification (Antiquité, continuité, pureté, abondance, facilité, etc.) qui entraîne inévitablement des locuteurs émotionnellement impliqués.
Dans les siècles les plus récents, la présence de grammaires, de dictionnaires et d'autres outils d'apprentissage et d'instruments de systématisation renforce l'idée que, en raison de leur caractère normatif, les langues peuvent être apprises par l'étude. Des histoires mythiques encouragent la réalisation de règles normatives et conduisent les locuteurs à relier leurs émotions à leur langue.
Dans ce contexte, les sujets de réflexion que nous voulons mettre en place dans ce IXe colloque sont les suivants :
1. Règles : Quel rôle a eu l'activité normative dans la construction, l'imposition et l'acquisition de chaque langue ? Dans quelle mesure les règles ont amélioré l'accès à un bon usage de la langue ? Dans quelle mesure existe-t-il des règles de base de l'identité linguistique ? Dans quel sens la linguistique ou de la grammaire sont-elles toujours normatives ? Peut-on dire que la réflexion sur une langue est ce qui construit cette langue?
2. Mythes : Chaque langue européenne a-t-elle construit un récit mythique, une (ou des) histoire(s) fondatrices ? Y a-t-il des mythes linguistiques universels et stables ? Toutes les cultures et toutes les époques ont-elle leurs mythes ? Quel est le sens et le but de chaque mythe linguistique ?
3. Émotions : Pourquoi y a-t-il des sentiments derrière les langues? Est-ce qu'une langue construite peut éveiller les mêmes sentiments que les dialectes ? Dans quelle mesure les émotions en matière de langues sont-elles similaires aux différentes? Comment les sentiments affectent-ils les attitudes linguistiques et, par conséquent, l'avenir des langues ?
Le colloque prévoit des sessions avec des communications de 20 minutes portant sur un des trois thèmes mentionnés. Les proposants doivent soumettre avant le 15 mars 2013 à l'adresse ghl@udg.edu un résumé de leur proposition en 150 mots avec les informations suivantes : titre, nom de l'auteur, fonction et employeur de l'auteur, pays, téléphone et courriel. Les langues acceptées sont toutes les langues romanes et l'anglais. La décision du Comité scientifique sera communiquée aux contributeurs concernés plus tard le 15 avril et les contributeurs devront confirmer leur inscription avant le 15 mai 2013.
Le texte de documents sélectionnés doivent être remis au plus tard au début du colloque. Le comité d'organisation prendra en charge les frais d'hébergement des auteurs des communications acceptées.
Comité scientifique : Francesc Feliu (Universitat de Girona), Joan Mascaró (Universitat Autònoma de Barcelona), Josep M. Nadal (Universitat de Girona), Mari D’Agostino (Università degli studi di Palermo), Anne-Marie Chabrolle (Université de Lorraine), Rosanna Sornicola (Università di Napoli-Federico II), Jean-Michel Eloy (Université de Picardie), Joan Ferrer (Universitat de Girona), Xavier Pla (Universitat de Girona).
Comité d'organisation : Josep M. Nadal, Francesc Feliu, Narcís Iglésias, Olga Fullana, Mercè Mitjavila, Natàlia Carbonell, Gemma Albiol, Blanca Palmada, Pep Serra (Universitat de Girona).
Partenaires :
ODELLEUM (Observatori de les Llengües d'Europa i la Mediterrània)
Institut de Llengua i Cultures Catalanes (Universitat de Girona)
Generalitat de Catalunya : Departament d'Economia i Coneixement
Avec le soutien de :
Departament de Filologia i Comunicació (Universitat de Girona)
Ministère de l'économie et de la compétitivité (gouvernement espagnol)
Information : ghl@udg.edu